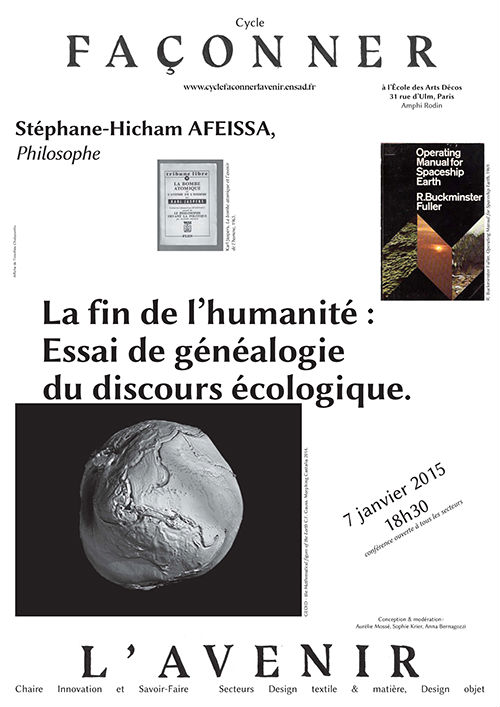STÉPHANE-HICHAM AFEISSA
« Je suis titulaire de deux doctorats, l’un de philosophie, délivré par l’Université de Lyon en 2012 (L’habitant du monde chez Kant et Husserl), et le second de géosciences & environnement, délivré par l’Université de Lausanne en 2014 (La fin du monde et de l’humanité. Essai de généalogie de pensée écologique). Après avoir longtemps travaillé sur la philosophie kantienne et la phénoménologie husserlienne, je me suis tourné vers la philosophie de l’environnement, et plus particulièrement du courant anglo-saxon d’éthique environnementale, que je me suis efforcé de mieux faire passer en France en traduisant les textes fondamentaux des principaux théoriciens de cette école. Dans la même inspiration, j’ai également travaillé à offrir des traductions des textes clés de ces deux autres courants philosophiques (…) que sont l’éthique animale et l’esthétique environnementale. Parallèlement à ce travail de passeur, j’ai tenté de développer une réflexion personnelle sur l’écologie, dans une série d’articles et d’essais, lesquels ont trouvé une forme d’aboutissement dans mon dernier livre paru en 2014. » – Stéphane-Hicham Afeissa

Énoncé de conférence:
Le discours écologique fait régulièrement l’objet d’une critique dénonçant son catastrophisme, son prophétisme noir et ses prédictions apocalyptiques. La référence à l’Apocalypse biblique y est effectivement présente, et fonctionne au reste dans les deux sens puisqu’il apparaît que les visions apocalyptiques contenues dans le Nouveau et dans l’Ancien Testaments faisaient déjà mention d’un certain nombre de désastres environnementaux au titre de signes avant-coureur de la catastrophe finale. L’interprétation écologique de l’apocalypse peut se comprendre aussi bien comme une interprétation de l’Apocalypse en termes des problèmes environnementaux que comme une interprétation des problèmes environnementaux en termes apocalyptiques. Mais la possibilité même d’un tel rapprochement, à ce jour, a toujours valu réfutation du discours écologique, ainsi fustigé pour ses outrances et son caractère anxiogène.
Nous nous proposons de prendre à la lettre le discours écologique, en examinant les emprunts (délibérés ou non) qu’il effectue à l’égard d’autres types de discours, sans réduire notre enquête à la seule Apocalypse biblique, mais en prenant en considération tous les discours qui se sont efforcés à un moment ou à autre de l’histoire des idées d’élaborer une représentation de la fin du monde et de l’humanité. Notre enquête se veut généalogique en ce sens où il s’agit pour nous de déconstruire le discours écologique en ses éléments constituants en plongeant dans l’intertexte qui le compose. Faire la généalogie du discours écologique ne signifie pas mettre au jour les antécédents historiques d’un tel discours, mais les équivalences discursives à la lumière desquelles il est possible de mieux en comprendre le fonctionnement.
Les objectifs que nous poursuivons en menant une telle enquête sont à la fois d’ordre descriptif et d’ordre normatif. Descriptif, en ce sens où il s’agit pour nous de comprendre de quelle manière nous pensons les problèmes soulevés par la crise environnementale en soumettant à analyse l’outillage mental dont nous nous servons ordinairement à cette fin. Normatif, en ce sens où nous voudrions montrer que la raison pour laquelle les problèmes écologiques sont parfois mal posés tient à ce qu’ils sont pensés en référence à d’autres problèmes élaborés dans d’autres cadres de pensée, de sorte que des transferts de schèmes discursifs se sont opérés d’un domaine de réflexion à un autre, conduisant à méconnaître la spécificité des problèmes posés par la crise environnementale.
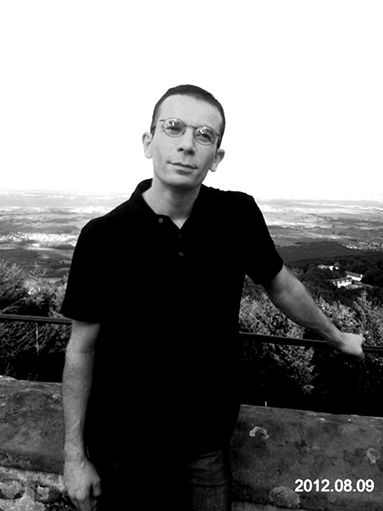
"Tour à tour chercheur, designer, artiste et sociologue, il se passionne depuis la fin de ses études sur les changements politiques et sociaux, relatif aux apparitions de nouvelles technologies. Jouant ainsi le rôle de celui qui observe, il décrypte souvent avant les journalistes, les enjeux colossaux pour ces industriels et propose des œuvres, plus que des objets de consommation, qui nous renvoient à notre propre responsabilité de client. Toutes ses productions ont une portée éducative et permettent au spectateur de prendre du recul sur ces nouvelles offres toujours plus attractives qui changeront, peut être, notre vie."
Victor Willaert, Design Objet 4e année

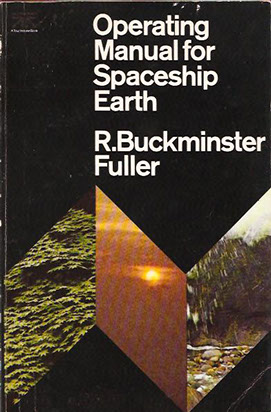
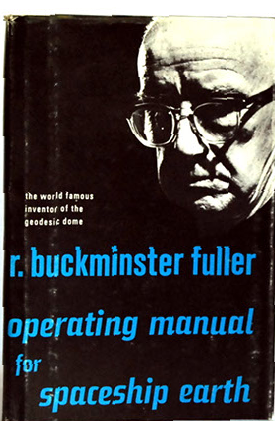
LINKS
http://www.nonfiction.fr/fiche-perso-415-hicham_stephane_afeissa.htm
www.artducomprendre.com/09.afeissa.doc
http://www.nonfiction.fr/article-6154-il_faut_de_tout_pour_faire_un_monde.htm
Bibliographie sélective :
1. Ethique de l’environnement. Nature, valeur, respect, Paris, J. Vrin, collection « Textes-clés », 2007, 380 pages.
2. Qu’est-ce que l’écologie ?, Paris, J. Vrin, collection « Chemins philosophiques », 2009, 125 pages.
3. La communauté des êtres de nature, Paris, Editions MF, collection « Dehors », 2010, 115 pages.
4. Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté (en collaboration avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer), Paris, J. Vrin, collection « Textes-clés », 2010, 380 pages.
5. Nouveaux fronts écologiques. Essais d’éthique environnementale et de philosophie animale, Paris, J. Vrin, collection « Pour demain », 2012, 193 pages.
6. Portraits de philosophes en écologistes, Paris, Editions Dehors, 2012, 341 pages.
7. Des verts et des pas mûrs. Chroniques d’écologie et de philosophie animale, Paris, PUF, hors collection, 2013, 284 pages.
8. La fin du monde et de l’humanité. Essai de généalogie du discours écologique, Paris, PUF, collection « L’écologie en questions », 2014, 397 pages.